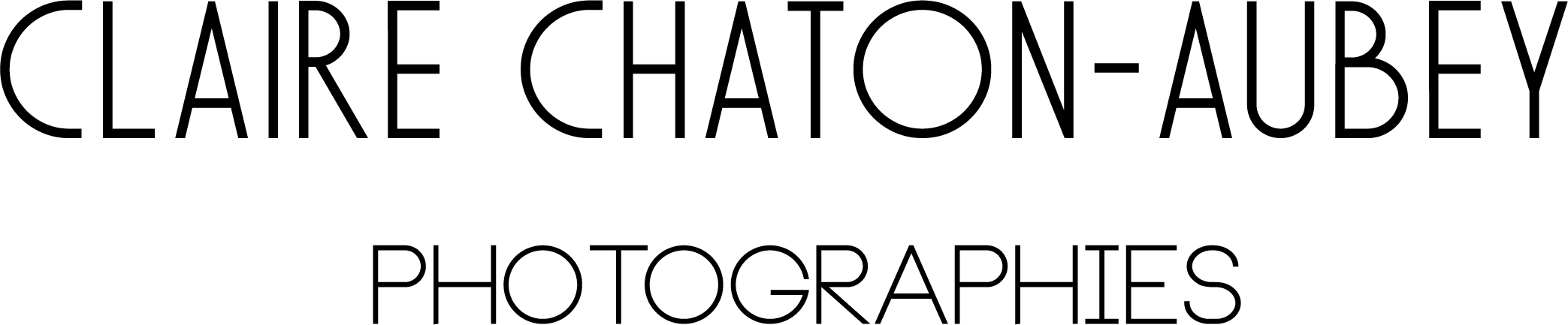C’est à Arles, en photographiant le Rhône depuis le quai de Trinquetaille, que m’est
venue l’idée d’un cadrage perpendiculaire au cours du fleuve, à l’inverse de ce qui se
fait généralement.
Impressionnée par sa puissance et son débit juste avant le delta, j’ai tenté d’en faire une
sorte de portrait instantané, débarrassé de tout ce qui peut parasiter la compréhension
directe de sa personnalité. Comme sur une coupe stratigraphique, se superposent sur
l’image les différentes couches : le quai antique rongé par l’humidité, le cours du fleuve
traversé de reflets, de remous et de zones d’ombre qui trahissent la violence des
courants, le quartier de la Roquette sur la rive opposée, et enfin, le ciel dans la chaleur
naissante de ce matin d’été.
Deuxième expérience avec la Loire à Blois. Même cadrage en section transversale,
même format, même intuition de capter l’identité profonde du dernier grand fleuve
sauvage d’Europe, avec sa lenteur, ses bancs de sable et sa surface en miroir. Et ce fut
très vite le début d’une série : la Saône à Heuilley, la Seine à Paris …
D’autres suivront au fil des balades.
 | « La profondeur se cache à la surface » : on ne peut mieux dire l’épaisseur historique Car Arelate duplex, « l’Arles double » du poète latin Ausone, est bien là sous nos yeux, Entre les deux, une des voies majeures de pénétration de la Méditerranée vers Le Rhône à Arles - août 2018 |
 | Blois, octobre 2018, par une belle fin d’après-midi d’automne. Après une journée bien remplie à courir d’une conférence à l’autre dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire - dont le thème, cette année-là, était « La puissance des images » - une petite ballade à la fraîche sur les bords de Loire s’imposait. Ce que dit la photo, ce sont les permanences du fleuve, l’harmonie et la douceur des paysages façonnés par la géographie et l’histoire, qui en a fait une ligne de partage toujours invoquée par les météorologistes : les bancs de sable blond et les herbiers sur lesquels s’ébattent les oiseaux, les lourds quais de pierre érigés sur chaque rive, le blanc du tuffeau et le gris de l’ardoise des habitats traditionnels. On devine à peine sur la droite l’arche d’un de ces grands ponts à l’architecture si caractéristique qui ponctuent son cours moyen. Mais elle dit aussi la possibilité de variations subites, les couleurs qui changent au fil des heures, le danger invisible des culs de grèves, la menace toujours présente des crues. Ce jour-là, sa surface en miroir offrait un jeu de dupes : lequel, du fleuve ou du ciel, reflétait l’autre ? La Loire à Blois- octobre 2018 |
 | C’est une des sections navigables de la Saône, où vient se greffer, à quelques Un pâle soleil d’hiver éclaire la scène : la berge est habillée de roseaux secs à peine Il y a parfois La Saône à Heuilley - février 2019 |
 | Lorsqu’on suit les voies sur berge de la Seine entre le quai de Gesvres et l’île de la Cité, Si le mode portrait et la stratigraphie horizontale qui caractérisent la série sont bien A travers la couleur gris-vert du fleuve, striée par les ombres des ponts, on devine un courant La Seine à Paris - mars 2019 |
 | Chantée par Victor Hugo, peinte par Degas, Seurat, Toulouse-Lautrec et bien d’autres, la Baie de Somme est d’abord un grand site naturel, à la rencontre des eaux douces du fleuve côtier et de la Manche. Dessinée par les marées, les vents et les tempêtes, recomposée par les activités humaines, elle est en évolution constante. Bordées de tourbières, ses eaux saumâtres offrent un habitat naturel ou un refuge à de nombreux oiseaux sédentaires et migrateurs. Ses bancs de sable abritent la première colonie de phoques veaux marins et de phoques gris de France. Des moutons de race locale et des vaches Highlands y paissent dans les prés salés, et de rares chanceux bénéficient de concessions pour récolter la salicorne. Fréquentés depuis 650 000 ans par les premiers groupes humains, attirés par la richesse de la flore et de la faune des milieux humides, les paysages de la baie ont vu la flotte de Guillaume le Conquérant partir pour l’Angleterre. Aujourd’hui avec le réchauffement climatique, ils sont en passe de devenir un haut-lieu du tourisme de nature. Au premier plan la slikke, épaisse couche de vasières recouvertes quotidiennement par la mer, échancrée par un petit affluent. Au-dessus, le fleuve à marée basse, dans-lequel se reflète une balise rouge qui délimite au fond le vert profond des mollières (schorre), pâturages d’exception submergés uniquement lors des grandes marées. Le cadrage met en valeur l'accord fragile, en perpétuel mouvement, entre terre et mer, entre vase et sable, entre eau et sel. La Baie de Somme à Saint Valery, juin 2023 |